
La Catalogne
a été une terre d’accueil
pour ces bonshommes persécutés
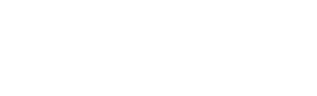
Lorsque l’on parle des cathares, ou des bonshommes, on sous-estime souvent les répercussions géopolitiques que ce phénomène religieux allait provoquer au cours de l’histoire médiévale de l’Europe.
L’Église catholique immobiliste des XIIe et XIIIe siècles partageait avec Paris les principes féodaux les plus rigides. Les États pontificaux étaient, en outre, les souverains d’un territoire qui couvrait la moitié de l’Italie actuelle, et Rome, en tant que chef de l’Église hégémonique en Occident, se préparait à lutter jusqu’à la mort contre l’esprit dangereux des citoyens libres qui se répandait dans les riches et splendides comtés occitans. Un esprit qui, associé au message évangélique cathare le plus populaire et à la souveraineté que la Maison de Barcelone étendait dans les pays occitans, menaçait l’équilibre géopolitique, la domination religieuse et la vassalité tributaire que Rome imposait à la mosaïque féodale de l’Europe à l’époque.
Si donc, avec la croisade contre les cathares, le pape de Rome détruisait, d’une part, une Église chrétienne indépendante qui avait commencé à s’enraciner fortement en Occitanie, d’autre part, il barrerait la voie, pour toujours, à l’expansion croissante de la Catalogne vers le Nord occitan.
En effet : des armées mercenaires, en mission de guerre sainte contre les hérétiques, dévasteraient le Languedoc et, après le génocide de populations entières, conquerraient – au nom de la France – le riche pays occitan où s’épanouissait la société la plus cultivée et la plus développée d’Europe. L’intervention du roi Pierre le Catholique, pour défendre les intérêts de la Catalogne-Aragon et de ses vassaux occitans, et sa confrontation avec l’alliance de Rome et de Paris se solderont par la défaite de Muret, un carrefour historique qui n’a jamais été suffisamment reconnu et qui déterminera l’évolution ultérieure des réalités nationales françaises, occitanes et catalanes jusqu’à nos jours.
Quelle était donc cette religion nouvelle et révolutionnaire qui serait utilisée par les rois et les papes, et qui donnerait lieu à une croisade cruelle et sanglante sans précédent des chrétiens contre les chrétiens et au génocide occitan ? Le catharisme

Contrairement à l’Église catholique romaine ostentatoire, corrompue et autoritaire du XIIIe siècle, le catharisme prônait une Église fondée sur la spiritualité et la charité, avec un retour aux valeurs les plus pures et les plus simples du christianisme primitif.
Le catharisme, qui au tournant du XIIIe siècle se répandait déjà à travers la Lombardie, l’Empire allemand, la Provence, les Pyrénées catalanes et, surtout, le Languedoc, rejetait le matérialisme, l’idolâtrie, la guerre – même si elle était défensive –, les valeurs féodales, et blasphémait l’organisation ecclésiastique coûteuse, arrogante et hiérarchique de Rome.
Les cathares, appelés aussi bonshommes et bonnes femmes, et aussi bons chrétiens ou amis de Dieu, rejetaient les temples et les cathédrales. Dieu, disaient-ils, ne réside que dans le cœur des fidèles. Une nappe blanche sur une table ou une pierre, dans n’importe quelle clairière de la forêt ou de la grotte, était l’autel, sur lequel était placé un Nouveau Testament traduit dans la langue d’oc, un fait absolument interdit par Rome. Comme seule prière, ils priaient le Notre Père, bénissaient le pain et le distribuaient parmi les croyants, comme cela se faisait dans les premiers jours du christianisme.
Les prédicateurs de l’Église cathare étaient appelés purs et âgés. Les inquisiteurs les appelleront plus tard parfaits. Il peut aussi s’agir de femmes, ce qui est inhabituel dans l’Europe du XIIIe siècle. Les « bonnes femmes » ne se distinguaient des autres femmes que parce qu’elles portaient leurs cheveux relevés et cachés. Les hommes, aux cheveux longs et à la barbe, portaient de longues tuniques noires et des robes en tissu de chanvre. Pour ceintures, ils portaient une corde avec autant de nœuds que les vœux qu’ils avaient formulés (saint François en copia l’habit). Ils se déplaçaient par paires, avec l’Évangile de saint Jean, et toujours avec une petite marmite personnelle pour éviter de cuisiner avec de la graisse.
Bien que le catharisme ait imposé des règles strictes à ses purs – renonçant aux choses matérielles, comme les rapports charnels et la consommation de viande – il était, en revanche, tolérant et flexible avec les croyants simples, qui n’étaient rien de plus que des hommes et des femmes simples qui, loin du fanatisme ou des lumières mystiques, cherchaient un refuge spirituel contre la sévérité rigide et l’intolérance du fondamentalisme catholique de l’époque. Il faut garder à l’esprit que l’Église catholique de l’époque tenaillait les gens et leur compliquait la vie avec une série interminable de dîmes, de pénitences, d’enterrements, de censures, de menaces et d’autres impositions.
Contrairement au clergé catholique, les prédicateurs cathares étaient des gens humbles et austères, mais cultivés et préparés. Beaucoup étaient des tisserands, et les plus cultivés pratiquaient la médecine. Ainsi, lorsqu’un homme pur prêchait, le peuple venait à lui avec respect et admiration. Avant la croisade, presque tous les nobles et chevaliers occitans – catholiques ou croyants cathares – accueillaient dans leurs châteaux les bonshommes et les bonnes femmes, au point de leur confier l’éducation de leurs enfants. Des monastères entiers furent convertis au catharisme, et même les évêques catholiques, mortellement malades, furent secrètement consolés par les anciens cathares.
L’influence cathare s’est répandue, inexorable, dans toutes les couches de la population : seigneurs, chevaliers, bourgeois, marchands, artisans, paysans et, surtout, parmi les femmes.
L’Église cathare disposait d’un réseau d’abris communautaires qui, une fois la croisade déclenchée, deviendraient des refuges. C’étaient des refuges où les femmes de tous âges et de toutes conditions – orphelines, veuves, dames nobles et paysannes – vivaient, travaillaient et étaient formées, notamment dans l’esprit et l’art du tissage, dans un environnement de liberté et de dignité inimaginable à l’époque.
Au tournant des XIIe et XIIIe siècles, la culture la plus avancée de l’Europe médiévale s’épanouit dans les pays occitans. Le solide substrat gréco-latin et l’efficacité du droit romain avaient résisté, d’abord, à l’occupation wisigothique et, plus tard, à l’occupation sarrasine, qui fut plus courte. Les vestiges de la civilisation classique avaient été protégés dans les vallées pyrénéennes dans une série de monastères – Sant Pere de Rodes, Sant Quirze de Colera, Sant Miquel de Cuixà, Sant Martí del Canigó, Sant Joan de les Abadesses, Ripoll, etc. – qui avaient non seulement fixé la culture gréco-latine, mais avaient également compilé de nouvelles traductions des classiques, de Cordoue et de Tolède, et le meilleur de la pensée islamique et juive. L’art et la culture romans qui émergent des deux côtés des Pyrénées seront en lien direct avec l’espace et l’environnement culturel catalano-occitan.
Le Languedoc et, par extension, toute l’Occitanie illuminent ainsi une société développée, raffinée et tolérante, qui est l’expression d’une civilisation – celle des troubadours – plus évoluée et avancée que celle des Français et des autres peuples du Nord. La philosophie et d’autres activités intellectuelles y étaient largement cultivées. Nobles et chevaliers y participèrent activement, l’encouragèrent et s’intégrèrent dans les cercles cultivés et littéraires à une époque où la noblesse du nord ne savait ni lire ni écrire. Il faudra attendre encore trois cents ans à l’Europe, jusqu’à la Renaissance, pour assister à une telle explosion culturelle.
Dans toute l’Occitanie, c’était la prospérité. La forte augmentation de la population, l’agriculture fertile, l’augmentation du cheptel et l’expansion de son propre secteur – en particulier le textile – ont conduit à la création de nouvelles villes et de nouveaux bourgs. Une civilisation urbaine sans précédent se développait et s’étendait à travers les villes occitanes et catalanes, et favorisait une économie ouverte qui contrastait avec l’économie rurale, fermée et féodale rigide du reste de l’Europe. Un commerce croissant encourageait l’échange permanent de personnes, de biens et d’idées entre la campagne et la ville. Des ports comme Narbonne et Montpellier, et des villes de l’intérieur comme Toulouse, Nîmes et Carcassonne, devenaient des centres de grande activité économique et des centres de production de richesses.
Dans ce contexte, il est très significatif de noter comment le catharisme s’inscrit dans les intérêts de tous les niveaux de cette société occitane évoluée. Les grands seigneurs étaient remplis de satisfaction qu’une religion prônât la suppression du féodalisme ecclésiastique et du pouvoir temporel de l’Église.
La bourgeoisie accueillait avec sympathie une interprétation du message de l’Évangile qui, contrairement au catholicisme, non seulement ne condamnait pas les activités mercantiles et financières, mais les favorisait même, puisque, dans la conception dualiste cathare, le monde artisanal et marchand représentait le bien, par opposition aux droits et privilèges féodaux, qui représentaient le mal.
Cependant, c’est parmi les classes populaires que le message cathare connaîtra le plus de succès, promouvant, avec la prédication exemplaire des bonshommes, un retour aux valeurs du christianisme primitif. Le message cathare était le message chrétien originel de salut et de consolation pour les pauvres, transmis dans un langage simple, spirituel et compréhensible, très éloigné de la rhétorique latine incompréhensible utilisée par l’Église catholique distante et bureaucratisée de l’époque.

Le catharisme vise à retrouver l’esprit religieux du christianisme primitif des premiers apôtres, avec une prédilection particulière pour les évangiles de saint Jean et les textes de Saint Paul, accompagnée d’un rejet de l’Ancien Testament.
Selon les cathares, l’Église chrétienne primitive se corrompt dès qu’elle est reconnue et assumée par le pouvoir, c’est-à-dire par l’empereur romain Constantin.
Il est à noter que la plupart des sources documentaires et informatives sur le catharisme proviennent des processus initiés et archivés par son principal ennemi : l’Église de Rome. La transcription des aveux extorqués aux hérétiques par les tribunaux de l’Inquisition était généralement effectuée par des fonctionnaires incultes qui n’étaient pas du tout enclins à refléter la réalité complexe et objective de la pensée cathare. C’est ainsi que s’est transmise et diffusée la vision la plus simple et la plus populaire du catharisme, avec une caricature pleine de clichés, une vision très éloignée de la gnose cathare et de la métaphysique qui donnaient un soutien philosophique à la doctrine des bonshommes. En fait, le catharisme a toujours eu des enseignants instruits d’un haut niveau culturel qui se souciaient de donner à la doctrine cathare une cohérence intellectuelle cohérente.
Le catharisme, à titre d’exemple, est la seule religion qui admet l’existence et l’importance, dans une conception du cosmos, du hasard absolu et du chaos. Le message cathare était donc à la fois philosophie et métaphysique, religion et culte.
Le dualisme cathare
Les cathares affirmaient l’existence de deux principes éternels et irréconciliables : le dieu de l’Être et du Bien, créateur du monde invisible et incorruptible des esprits bons et immuables, et le dieu du Mal, créateur du monde matériel, corrompu et chaotique.
L’éternité bonne, infiniment stable, est confrontée à l’éternité mauvaise, constituée par les éléments matériels et spirituels instables et grossiers – les mauvais esprits – qui composent ce monde, changeant d’éléments dans une agitation contradictoire permanente.
Le dualisme éthique de la pensée chrétienne – le bien contre le mal, l’esprit bon contre la chair, le plus élevé contre le plus bas – est donc interprété par les cathares avec une dimension cosmologique.
Face à la proclamation catholique d’un Dieu suprême et d’un diable inférieur, dont le mal se manifeste dans l’être humain et dans ses actes, le catharisme donne au mal une catégorie plus large qui s’incarne dans la matière.
Tout ce qui est matériel – le monde, le pouvoir, etc. – est intrinsèquement mauvais, tandis que le Bien est un être ou un esprit pur et désincarné, sans matière, il est le Dieu d’Amour.
L’univers est donc l’œuvre du Dieu du Mal, le roi du monde (Rex Mundi).
L’être humain a une double nature. Son corps, matériel et corruptible, appartient à Satan, tandis que son âme ou pur esprit appartient à Dieu. Satan, l’organisateur de la matière, aurait provoqué la révolte des esprits – les anges – avec leur chute et leur emprisonnement dans la matière – les corps – d’où ils ne pouvaient sortir rachetés que par l’expiation et la purification.
Jésus était, selon les cathares, un ange envoyé par Dieu pour enseigner aux hommes le chemin de la purification et de la libération des esprits, c’est-à-dire le chemin du ciel.
Sa mort sur la croix doit être interprétée comme un symbole, mais sans but ni efficacité salvatrice pour l’humanité.
Pour les cathares, la rédemption doit être recherchée par soi-même, avec le développement spirituel de chacun. Ils rejetaient donc l’exaltation et l’adoration de la croix, qui devint même un symbole du Rex Mundi, seigneur du monde matériel.
L’adoration de la croix, comme celle des images, constituerait donc une idolâtrie et un outrage à la nature divine du Bien.
Face à la vision simpliste, mais terrifiante que l’Église catholique offrait du diable, les cathares s’opposaient à une conception plus évoluée de Lucifer en tant qu’ange rebelle, non spirituel et incarnation du monde matériel, qui devait être combattu par le chemin de la spiritualité.
L’organisation du monde satanique, selon les cathares, sera détruite à la fin des temps. Mais le Mal continuera à subsister dans l’ensemble des éléments chaotiques. La Terre, déjà abandonnée par toutes les bonnes entités et les âmes sauvées, brûlera et deviendra le véritable enfer, l’habitat naturel et exclusif du diable laissé à lui-même. Dans l’impuissance éternelle, l’Être ne pourra plus dominer, ni corrompre, ni faire quoi que ce soit contre le Dieu de la lumière, des justes et du Bien.
Pour les cathares, le temps était éphémère, changement et corruption par définition, contrairement à la stabilité permanente ou à l’éternité du Bien.
Les cathares croyaient aux réincarnations successives d’âmes ou d’esprits dans un sens ascendant d’amélioration, de purification progressive et d’approche du Bien, et donc de s’éloigner du Mal matériel et corrompu des corps.
Au lieu d’accepter la foi de seconde main des catholiques – et le rôle d’intermédiaire de l’Église de Rome – les cathares n’acceptent que la connaissance directe et personnelle avec Dieu, dans une défense de l’expérience religieuse et mystique perçue de première main.
La sexualité
La reproduction du Mal mortel et matériel ne pouvait être évitée qu’en renonçant à la reproduction sexuelle humaine. L’Église cathare a donc promu la chasteté terrestre afin de se rapprocher de l’amour divin primordial.
Dans la pratique, cependant, les cathares étaient réalistes. Bien qu’ils aient reconnu que la procréation de la chair signifiait la reproduction du Mal matériel, ils n’étaient pas naïfs au point d’interdire la sexualité, qu’ils acceptaient comme un moindre mal parmi les croyants. Et bien que la chasteté soit exigée des purs, même ces enseignants et pasteurs de l’Église cathare étaient généralement des hommes et des femmes âgés qui avaient déjà fondé une famille. La figure d’Esclarmonda de Foix en est un exemple très significatif. On suppose que les cathares pratiquaient un certain contrôle des naissances et l’avortement, ce qui a dû provoquer la colère, facilement imaginable, de la Rome du XIIIe siècle.
Le « melhorament » (amélioration) était un rite par lequel le croyant réaffirmait sa fidélité à l’Église cathare, saluait le maître ou le pur, et lui demandait de l’aide pour s’améliorer.
Le « consolamentum » était le rite ou le baptême spirituel par lequel, par une simple imposition des mains, une personne pure en ordonnait une autre. C’était aussi le rite par lequel ceux qui allaient mourir étaient assistés, qu’ils soient purs ou croyants.
Avec le « consolamentum », on prétendait empêcher l’âme, après la mort, de transmigrer dans un autre corps matériel, au lieu de monter vers l’éternité du Bien.
L’« endura » était le suicide mystique ou l’abandon de ceux qui, après avoir reçu le « consolamentum », et à l’article de la mort, en raison de la maladie ou de la vieillesse, demandaient à arrêter de se nourrir.

Pour les cathares, il n’y a qu’un seul système à travers lequel les enfants peuvent commencer le chemin du salut et se connecter avec Dieu, et c’est la charité.
La charité devient le lien d’amour qui unit l’homme à Dieu, parce qu’elle lui donne une identité ontologique et un esprit bienveillant et incorruptible, contrairement aux mauvais esprits et à l’ensemble des choses matérielles, toutes corrompues.
Celui qui n’a pas la charité n’a pas d’identité définie. Les mauvais esprits ont été créés en dehors de la volonté du Bien, qui est l’éternité et la stabilité permanente, et donc ils ne le sont pas.
Contrairement aux principes masculins et autoritaires de l’Église catholique romaine, les cathares s’opposaient à un principe féminin, tolérant et charitable du sentiment religieux.
La doctrine cathare pourrait se résumer en trois principes : aimer son prochain comme soi-même, ne pas nuire ou prendre la vie de son prochain ou d’animaux, et spiritualiser, se déifier jusqu’à ce que l’âme – dans la mort, et sans regret – quitte le corps.

La Catalogne
a été une terre d’accueil
pour ces bonshommes persécutés

Le Chemin
était leur espace d’évangélisation
ils ont rejeté les biens matériels

Les bonshommes
étaient considérés comme des hérétiques,
persécutés et exterminés
Lorsque la croisade contre l’Occitanie commença à faire des ravages, de nombreux nobles occitans et cathares se réfugièrent dans les maisons de leurs parents et amis dans les terres catalanes du Roussillon et de l’autre côté des Pyrénées, en particulier en Cerdagne, à El Berguedà et dans l’Alt Urgell. Ils furent très bien accueillis, tant par la Maison de Barcelone que par l’Église catholique catalane, car ils représentaient le capital et, surtout, les forces de repeuplement pour la reconquête contre les Sarrasins. Les cathares occitans furent donc reçus, en général, avec toute sympathie. De plus, la structure sociale catalane était similaire à la structure occitane, de sorte que le catharisme s’accordait également très bien avec les différents intérêts des classes sociales du pays.
Une bonne partie des seigneurs de la cour du comte de Roussillon et de Cerdagne – Nunó Sanç – embrassèrent la cause cathare et occitane et prirent une part active à la lutte contre le génocide perpétré par Simon de Montfort. Ces grandes familles catalanes-occitanes, ayant des liens familiaux, culturels, militaires et économiques étroits entre elles, subiront plus tard les persécutions de l’Inquisition et paieront cher ce soutien à la cause catharo-occitane.
Guillaume de Niort, beau-frère du comte de Roussillon, sera condamné, à son titre de cathare, à la réclusion à perpétuité. Le seigneur des châteaux de Termes et d’Aguilar, Raymond de Termes – son fils, Olivier de Termes, jouira de l’amitié du roi Jacques Ier – meurt dans les cachots de Carcassonne, emprisonné par Montfort. Le Père de Saissac, vicomte de Fenollet i d’Illa – ses descendants joueront un rôle de premier plan dans l’histoire du royaume de Majorque – sera condamné comme hérétique à sa mort (1262), et ses restes seront déterrés pour être brûlés. Bernat d’Alió, seigneur des châteaux de So et de Queragut, et marié à Esclarmonda, fille du comte de Foix et de son amante, avait aidé les assiégés de Montségur. Bernat d’Alió (ou de Llo) sera brûlé vif, comme hérétique, à Perpignan (1258).
Un cerdan de confession cathare éminent fut Arnau de Saga, qui, comme Arnau de Castellbò, participa à la dévastation de nombreuses églises.
Les familles d’Ot de Parets-tortes – aujourd’hui Peyrestortes – étaient également cathares, dont les restes, ainsi que ceux d’autres chevaliers catalans qui ont combattu contre Montfort, seront déterrés et brûlés par les hérétiques. Ponce de Vernet, membre de la suite de Pierre le Catholique et de Jacques Ier, sera également condamné après sa mort. Le brave Robert de Château-Roussillon eut plus de chance : emprisonné à plusieurs reprises par les inquisiteurs, il réussit finalement à sauver sa vie en échange d’aller se battre pendant trois ans contre les Sarrasins.
Aussi le dernier défenseur du château de Quéribus, Jaspert de Barberà, condamné pour hérétique, et qui avec Olivier de Termes, Ponç de Vernet et Castellrosselló avait accompagné le comte de Roussillon dans la conquête de Majorque, sauvera sa vie grâce à l’intervention du roi Jacques.
Aujourd’hui, il y a des auteurs qui suggèrent que Bellver de Cerdanya était un lieu important de passage et d’arrivée pour les cathares qui, fuyant la sanglante croisade anti-occitane et l’Inquisition, sont allés chercher la protection des seigneurs de Gósol, Josa et Castellbò, entre autres. Bellver reçut la charte de la ville des mains du comte Nunó Sanç en 1225, onze ans après la bataille de Muret et en pleine répression des cathares en Languedoc, ce qui rend probable – comme le souligne très bien Joan Pous i Porta – qu’une grande partie des habitants de la nouvelle ville de Bellver, profitant de la protection et des franchises accordées par Nunó Sanç, étaient d’origine cathare. Il est suggéré que les stèles funéraires discoïdales de Pedra et Talló, à Bellver, témoigneraient de certaines formes clandestines de culte cathare.

Jordi Ventura nous apprend que le catharisme s’était déjà enraciné en terres catalanes avant la croisade anti-occitane. Retrouvez des activités cathares documentées en Andorre, La Tor de Querol, Bagà, Berga, Josa, Gósol et Castellbò. Certains auteurs en trouvent également des traces plus tard à Puig-reig et Vallcebre. Ramon de Josa, son épouse et son frère Guillem Ramon adoptèrent ouvertement le catharisme. Ramon de Josa en 1232, après avoir été un temps son détracteur. Ramon de Castellarnau, Berenguer de Pi et, surtout, Arnau de Castellbò défendirent également le catharisme sans réserve.
Il semble que l’Église des bonshommes ait même eu des diacres attachés à ce territoire, avec des résidences à Josa, Castellbò et Berga.
Le seigneur de Castellbò soutenait, avec l’alliance des comtes de Foix, une longue lutte contre l’hégémonie croissante de l’évêché catholique d’Urgell. En 1198, Arnau de Castellbò profana et pilla une grande partie des églises de la Cerdagne, dont celles de Coborriu et de Pedra. Pous i Porta nous raconte le détail anecdotique que, ne pouvant entrer dans l’église de Talló, le seigneur de Castellbò a pris 8 bœufs et 18 porcs dans ses fermes.
Arnau de Castellbò participa à la bataille de Muret, aux côtés du roi Pierre et du comte de Foix. Sa loyauté envers la Maison de Barcelone l’amènera plus tard à faire partie du conseil royal du roi Jacques. Le mariage de la fille d’Arnau de Castellbò, Ermessenda, avec le comte de Foix, Roger Bernat II (1208), renforcera encore une alliance d’intérêts communs contre la mitre d’Urgell, tout en accentuant l’engagement de la famille Castellbò envers le catharisme. Il ne faut pas oublier qu’Ermessenda vivra à la cour de Foix avec la célèbre Esclarmonda de Foix, la tante de son mari. D’autre part, la sœur d’Arnau de Castellbò, également cathare, contribuera à renforcer, en épousant Raymond de Niort, le réseau de liens et d’intérêts communs entre les grandes familles des deux côtés des Pyrénées.
Les évêques d’Urgell, en conflit permanent sur les droits féodaux du comté, ne pardonnèrent pas à la famille Castellbò même après sa mort. Le long procès inquisitoire, mené par les dominicains Père de Cadireta – Inquisiteur général – et Guillem de Calonge, se terminera par une condamnation pour hérésie et l’exhumation des corps du vicomte et de sa fille, qui furent enterrés à Costoja (1269). Leurs cadavres furent brûlés et leurs cendres dispersées. Apparemment, le Père de Cadireta ne put pas beaucoup profiter de la scène, car, comme le dit Esteve Albert, toute la ville de Castellbò le lapida à quelques pas de la ville.
Du pacte paritaire (Les Paréages d’Andorre : 1278-1288) qui mettrait fin au litige ouvert entre la famille Castellbò – et plus tard ses successeurs, la famille de Foix – et les évêques et seigneurs d’Urgell, découlerait, au fil des siècles et jusqu’à nos jours, de la réalité historique et souveraine – reconnue aujourd’hui par l’ONU – des Vallées d’Andorre, avec sa base juridique particulière, résultat de l’accord, enfin, entre deux puissances féodales en désaccord.
Berga fut aussi, au cours du XIIIe siècle, un important point de pénétration et de diffusion du catharisme en Catalogne. La figure de Bernat de Bretós et de toute sa famille, grands diffuseurs du message cathare, se distingue. Nous savons que Bernat de Bretós était à Castellbò, à Josa del Cadí, à Vall Porrera et dans les montagnes de Siurana de Prades, et qu’il a également voyagé à travers l’Ariège afin d’aider ceux qui étaient persécutés par la croisade. Sa dévotion le conduira à défendre le dernier bastion cathare occitan, Montségur. Le 16 mars 1244, et avant d’abjurer sa foi, Bernat de Bretós préféra mourir brûlé sur le bûcher du Champ des brûlés, comme l’une des deux cent quinze victimes qui, parmi des hommes, des femmes et des enfants, ont donné leur vie dans cet holocauste cathare.
Une autre histoire est celle d’Arnau de Bretós, dont la relation avec le catharisme est connue depuis 1214. En 1241, il fut ordonné parfait à Montségur, puis retourna en Catalogne pour prêcher parmi les communautés hérétiques de la chaîne de montagnes de Prades, dans le Priorat. Il tenta finalement de fuir vers le nord de l’Italie, mais fut arrêté par l’Inquisition à mi-chemin. Arnau de Bretós fut interrogé par l’inquisiteur Ferrer de Vilaroja, un frère dominicain qui mena l’interrogatoire d’une bonne partie des survivants de Montségur, et procéda à l’extraction de toutes les informations qui pourraient être utiles à son travail de manière méticuleuse et méthodique, tout comme les inquisiteurs savaient le faire. Grâce à cet interrogatoire, nous savons qu’Arnau de Bretós et sa famille avaient déjà eu des contacts avec les cathares à Berga vers 1214, date qui constitue le premier témoignage certain de la présence des cathares dans le sud de la chaîne de montagnes pyrénéenne.
Un autre personnage très populaire qui a été lié au catharisme est le seigneur et troubadour Guillem de Berguedà. Bien qu’il ne puisse affirmer qu’il était cathare, il combattit aux côtés d’Arnau de Castellbò contre l’évêque d’Urgell, et traita les cathares, dans sa poésie et dans ses domaines, avec considération et sympathie.
De l’œuvre de Joan Serra i Vilaró, nous tirons le fait qu’en 1255, Galceran IV, baron de Pinós – qui avait le siège de sa vaste baronnie à Bagà – a accueilli certains des sujets de l’archevêque de Narbonne comme prisonniers pour cause d’hérésie.
La revendication fut réitérée l’année suivante, en 1256, cette fois auprès de l’archevêque de Tarragone, qui fit arrêter quatorze personnes de Gósol, également pour hérésie. Les sujets de Galceran de Pinós furent transférés dans les prisons de la baronnie, mais rapidement libérés, ce qui démontre – comme le souligne Xavier Pedrals i Costa – l’attitude permissive et tolérante des différents seigneurs de la région envers les hérétiques.
L’importance de la ville de Gósol dans l’hérésie cathare est démontrée par un document de l’Inquisition du milieu du XIIIe siècle, qui comprend le témoignage d’une femme d’ici, Maria Poca, qui explique que « peu d’auberges à Gosal étaient libres d’hérétiques ». Nous connaissons même les noms d’une quinzaine d’entre eux, car ils ont été condamnés et enfermés à la prison de Tarragone.
Jordi Ventura met également en avant la présence cathare dans les terres repeuplées. On a documenté un point important à Lleida, montrant que les cathares durent payer de grosses sommes (1257) pour le crime d’hérésie découvert par l’Inquisition.
De nombreux cathares viendront en effet repeupler les terres du sud de la Catalogne, et ont laissé des témoignages de leur présence dans les villes de Prades, Siurana, l’Arbolí, Cornudella et la montagne de Gallicant.
Tant pour retracer les traces du catharisme en Catalogne que pour approfondir l’ensemble du contexte historique et socio-économique occitan dans lequel l’Église des bonshommes a émergé, s’est développée et a été exterminée, nous vous suggérons de lire les travaux de recherche rigoureux menés par Jordi Ventura-Subirats, de qui nous nous considérons redevable, et dont nous incluons les principaux à la fin, dans la bibliographie recommandée.
